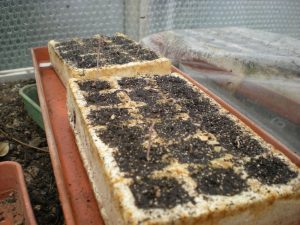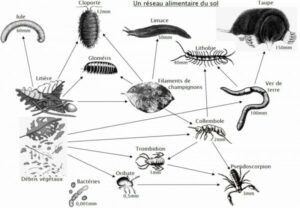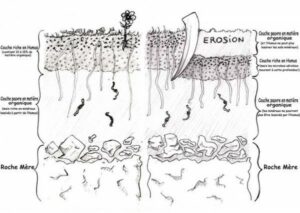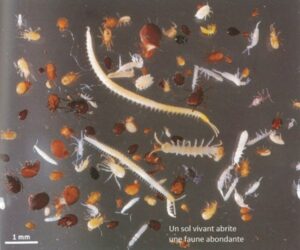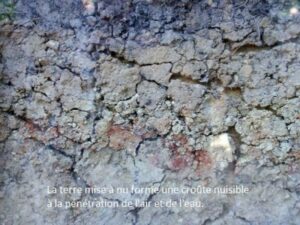Gâteau breton de Claudine
Bonjour !
Claudine m’a chargé de vous transmettre sa recette du gâteau breton.
En préambule,
Je vous dirai –je ne veux pas être désagréable- que ceux ou celles qui utilisent une balance journellement devraient, à mon avis passer leur chemin afin de ne pas éprouver des tentations ou remords épouvantables, car, dans l’histoire qui nous amène ici, la balance va exclusivement servir à peser des ingrédients pas compatibles du tout avec un régime !
Les ingrédients :
- 450 gr de farine, la meilleure, la Francine Suprême (en boîte de carton),
- 350 gr de beurre : les finistériens trouvent facilement le beurre (demi-sel bien sûr) de baratte Le Gall…il faut un très bon beurre !
- 350 gr de sucre, le St Louis extra fin est extra,
- 6 + 1 beaux jaunes d’œufs,
- 1 sachet de levure,
- quelques cuillerées à soupe de crème de pruneaux, genre Andros (en pot de verre).
LE MEILLEUR : oubliez la crème de pruneaux et répartissez, entre les deux couches de pâte, un nombre certain de pruneaux dénoyautés, c’est le top !
- du papier pour cuisson
- un plat rectangulaire 28x18x8 cm ou équivalent.
La préparation :
Avec de si bons ingrédients, il serait dommage de confier l’affaire à un robot, genre celui qui a pour nom, le prénom du p’tit copain de Barbie (la poupée, bien sûr) et qui habite dans les bois (en anglais) ! Vous suivez ?
Donc, Mesdames, vous allez ôter vos bagues et mettre les mains à la pâte !
- mélanger la farine et la levure, facile !
- ajouter le beurre, bien mou, facile !
- ajouter un à un les 6 jaunes, mon tout colle bien les mains !
- trouver une âme charitable pour verser le sucre en pluie sur la pâte et vos mains : bien malaxer, un plaisir, afin que le sucre fonde bien.
C’est presque fini !
Vous avez maintenant devant vous une belle boule d’un jaune magnifique.
Coupez –la en 2 parts égales : vous allez étaler la première part dans le plat où vous aurez préalablement placé une feuille de papier cuisson. (user du rouleau)
Puis, vous allez étaler sur cette pâte quelques cuillerées de crème de pruneaux en veillant à ne pas l’étaler sur les bords (laisser 1 cm de libre)
Enfin, prenez la deuxième part de pâte et étalez-la dans le plat en pressant légèrement sur les bords afin que la pâte du dessus se soude avec celle de dessous.
Les finitions :
Etaler et lisser le dessus du gâteau avec le dos de la cuiller à soupe et le dernier jaune d’œuf ; puis, avec une fourchette, tracer de belles rayures obliques en croisant, cela fera un beau damier… jaune !
La cuisson :
Votre four, je ne le connais pas, nous n’avons pas été présentés !
Sachez que le nôtre cuit le gâteau en 48 minutes à 180°, en chaleur tournante.
IMPORTANT : avec ce jaune d’œuf et tout ce beurre, le gâteau dore très vite aussi, je vous en prie, surveillez de très près la fin de la cuisson et n’hésitez pas, si cela dore trop vite, à placer une feuille de papier d’alu sur le plat… cela vous évitera de sortir un gâteau trop bronzé !
Le gâteau se coupe en suivant les rayures : cela fait des morceaux en forme de losanges, p’tits ou gros, c’est (expression en vogue) une tuerie !
Amis bretons, amis belges, amis de Franche –Comté et d’autres contrées,
Profitez et usez de cette recette !
Nous ne sommes pas trois vieilles mémés acariâtres, nous ne vous dirons pas « Pirates !! »
Jean-Paul et Claudine