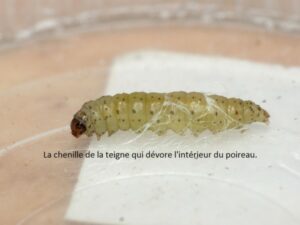Hydrangea et autres hydrangéacées des sous-bois asiatiques par Fabrice Gautier
Conférence qui n’a pas donné lieu à un compte-rendu, seulement une présentation générale
Fabrice Gautier est jardinier pépiniériste, passionné d’hydrangea pour lesquels sa pépinière « Sous un arbre perché » sise à Guerlesquin (Finistère) a été labellisée deux fois Collection Nationale par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) : « Hydrangea serrata » et « Hydrangéacées asiatiques ».
Il a rédigé un article en 2016 sur les H. serrata dans « Hommes et Plantes » (revue du CCVS).
Cette conférence n’a abordé que le côté Hydrangea des forêts d’Asie (donc ni macrophylla, ni paniculata, ni quercifolia, ni arborescens).
Elle a porté sur la présentation et la répartition géographique des différentes familles d’Hydrangea que l’on peut trouver dans les milieux ombragés d’Asie, à savoir :
- les H. aspera,
- les H. serrata,
- les H. involucrata,
- les H. petalanthes,
- les hydrangéacées herbacées…
Ainsi nous avons découvert la richesse insoupçonnée de ce que nous nommons parfois de façon simplifiée les hortensias.
Voici un petit rappel en photos de cette belle conférence.
Merci Fabrice !
Date : 18 novembre 2017
Photos / texte : Fabrice Gautier, pépiniériste ‘Sous un arbre perché’, Kervocu, 29650 Guerlesquin